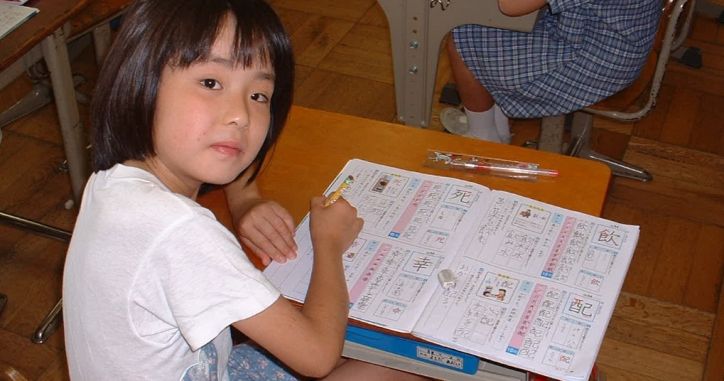Asie-Pacifique : les dirigeant·e·s syndicaux·ales réaffirment leur engagement de défendre la liberté académique en tant que pierre angulaire de la démocratie
Les menaces croissantes pesant sur la liberté académique et l’autonomie institutionnelle imposent aux syndicats de l’éducation d’élaborer des stratégies collectives pour les défendre. Lors de la Conférence de la région Asie-Pacifique sur la liberté académique et la démocratie, les syndicats ont échangé leurs points de vue et déterminé la marche à suivre.
L’événement, organisé par la région Asie-Pacifique de l’Internationale de l’Éducation (IEAP), s’est tenu à Kochi, dans la province du Kerala (Inde), du 15 au 17 octobre 2025 et a rassemblé plus de soixante éducateur·trice·s, responsables syndicaux·ales, chercheur·euse·s et défenseur·euse·s des politiques de la région et au-delà.
Dans son allocution de bienvenue, le directeur régional de l’IEAP, Anand Singh, a souligné « qu’il ne saurait y avoir de démocratie sans liberté académique, pas plus que de liberté académique sans autonomie professionnelle des enseignants et enseignants ».
Il a également réitéré l’engagement de l’IEAP de soutenir les syndicats de l’éducation dans la défense des droits des enseignant·e·s et de faire en sorte que les établissements universitaires restent des espaces de recherche libre et de débat démocratique.

Le secrétaire général de l’IE, David Edwards, a souligné que dans la région Asie-Pacifique et dans le monde entier, des pressions croissantes sur les institutions démocratiques et le rétrécissement de l’espace civil s’accompagnent d’attaques toujours plus nombreuses contre l’autonomie des enseignant·e·s et des chercheur·euse·s.
Les syndicats de l’éducation se situent aux avant-postes de la résistance à ces tendances. M. Edwards a déclaré : « Nous ne défendons pas simplement la liberté de membres individuels du personnel académique. L’enjeu ici est la capacité même de l’enseignement supérieur et de la recherche à servir de moteur de changement positif dans la société. Il s’agit de la quête de la vérité et de la poursuite des idéaux mêmes qui sous-tendent les sociétés démocratiques. »
Points de vue mondial et régional
La journée d’ouverture de la conférence donne le ton avec deux séances plénières consacrées à la présentation de l’état de la liberté académique aux niveaux mondial et régional.
Des orateur·trice·s venu·e·s d’Argentine, du Zimbabwe, de Suède et des États-Unis ont présenté des perspectives mondiales montrant que la liberté académique est de plus en plus menacée par des responsables politiques autoritaires, des pressions commerciales et une violence ciblée à l’égard des enseignant·e·s.
Des expert·e·s d’Allemagne, du Japon et de Nouvelle-Zélande ont également abordé les réalités régionales, en insistant sur le rétrécissement de l’espace démocratique, la précarité croissante du personnel académique et l’augmentation de la censure et de l’autocensure dans les établissements d’enseignement supérieur.
Au cours d’une session consacrée au thème « Censure, idéologie et autoritarisme », des exposés ont été présentés par l’Inde, les Philippines et l’Australie et les participant·e·s ont discuté du contrôle idéologique sur les programmes de cours, de la stigmatisation et de la surveillance des syndicalistes ainsi que de la réduction au silence du personnel académique sous l’effet de l’ingérence politique.

La journée s’est terminée par des discussions en table ronde axées sur le renforcement de l’autonomie professionnelle et la révision des normes internationales, en particulier la Recommandation de l'UNESCO de 1997 concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur.
La liberté académique est un droit humain
La deuxième journée de la conférence a traité de la liberté académique en tant que droit humain et responsabilité collective. Animée par Avelino Jr. Caraan (NATOW/Philippines), la première session sur « Le droit à la liberté académique en tant que droit humain » a présenté les points de vue de la Thaïlande, de l’Inde et du Myanmar. Mme Anita Rampal (Inde) a rappelé aux participant·e·s que « la liberté académique n’est pas un privilège accordé par les gouvernements, mais un droit humain fondamental. Le nier constitue une violation de ce droit. »
La session suivante sur le thème « Technologie, intelligence artificielle et surveillance », animée par Julie Douglas (Nouvelle-Zélande), était axée sur l’utilisation croissante de systèmes de surveillance numérique et de plateformes de données centralisées qui menacent l’autonomie académique. David Robinson (Canada) a souligné que « la liberté académique doit rester exempte de toute ingérence extérieure, qu’elle soit politique, commerciale ou numérique », tandis qu’Ajoy Ashirwad Mahaprashasta de The Wire – un site web indien non commercial d’information et d’opinion – a mis en garde contre les effets paralysants de la surveillance sur les discussions en classe et la liberté de recherche.

Deux ateliers parallèles se sont concentrés sur l’autonomisation des enseignant·e·s par le biais d’actions de plaidoyer fondées sur les droits et de la syndicalisation et sur l’impact du gestionnariat, la précarité de l’emploi et la privatisation des personnels de l’éducation dans l’enseignement supérieur.
La journée s’est terminée par une table ronde animée par Urmila Singh (Fijian Teachers' Union-FTU), au cours de laquelle des intervenant·e·s de Corée du Sud, des Philippines et des États-Unis ont pris la parole. Samuel Dunietz de la National Education Association américaine (NEA) a mis en évidence la manière dont les attaques indirectes, telles que les coupes dans les fonds de la recherche ou la suppression de subventions, sapent la liberté académique. La session a réaffirmé que des mécanismes solides de négociation collective, des mesures de protection juridique et des actions soutenues de plaidoyer sont essentiels pour faire en sorte que la liberté académique soit toujours protégée au profit de l’ensemble du personnel de l’éducation et des étudiant·e·s de la région.
La liberté académique est un bien public
La dernière journée s’est ouverte sur un exposé phare sur la « Liberté académique en tant que bien public », prononcé par Gurumurthy Kasinathan (IT for Change in India). Il a souligné le fait que la liberté académique doit être vue comme un élément essentiel d’intérêt public et a appelé les syndicats de l’éducation à diriger les débats publics sur la liberté académique à l’ère du numérique. Il a également mis en garde contre l’influence larvée de la commercialisation et d’une gouvernance axée sur la surveillance dans l’enseignement supérieur.
Les rapporteur·euse·s des sessions précédentes ont présenté des résumés des débats et des recommandations sur un large éventail de préoccupations, telles que la censure, le contrôle idéologique, le gestionnariat et l’érosion des droits académiques. Les délégué·e·s ont souligné l’urgence de mettre en place une solidarité transnationale et de mener une action syndicale collective pour renforcer les espaces démocratiques dans l’enseignement supérieur dans toute la région.
Au cours de la séance de clôture, le secrétaire général de l’IE, M. Edwards, a appelé à élaborer des stratégies régionales et des campagnes fondées sur des données factuelles pour lutter contre l’influence croissante de l’intelligence artificielle et des systèmes de données sur l’autonomie académique et institutionnelle. M. Singh de l’IEAP s’est félicité de la qualité des débats et de l’esprit de solidarité de la conférence et a proposé la création d’un comité de pilotage régional sur la liberté académique et la démocratie afin de maintenir cet élan par des actions continues de plaidoyer, un suivi et la documentation des atteintes à la liberté académique dans la région Asie-Pacifique.

Engagement collectif et voie à suivre
La conférence s’est achevée sur une ferme réaffirmation collective que la liberté académique fait partie intégrante de la démocratie, d’une éducation de qualité et du progrès social. Les participant·e·s se sont engagé·e·s à la défendre en recourant à une collaboration régionale, des recherches conjointes, des campagnes de plaidoyer et des partenariats avec des institutions internationales comme l’UNESCO et l’Organisation internationale du Travail.
Dans le message de clôture conjoint, l’IE et ses organisations membres ont réaffirmé leur détermination à faire en sorte que les universités et les écoles demeurent des espaces de libre-pensée, de questionnement et d’engagement démocratique et à développer une solidarité régionale afin de protéger le personnel de l’éducation et les étudiant·e·s chaque fois que la liberté académique est menacée.