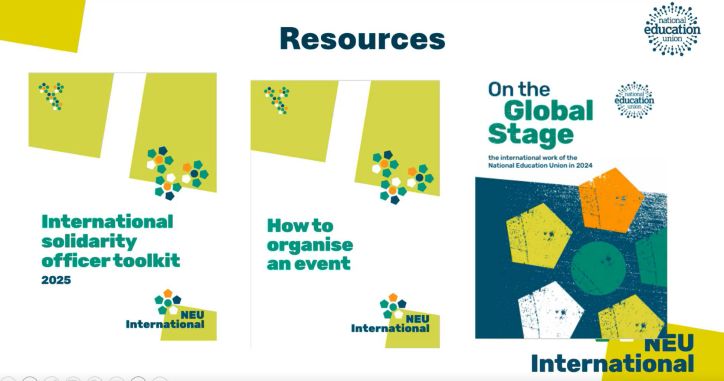Éthiopie et Népal : la campagne « La force du public » affiche de bons résultats grâce à la solidarité et à un plaidoyer stratégique
Dans un monde où les systèmes éducatifs sont de plus en plus menacés par les mesures d’austérité et la privatisation, la campagne de l’Internationale de l’Éducation (IE) « La force du public » apparaît comme un puissant moteur de changement. C’est ce qu’a révélé le récent Café de la coopération au développement de l’IE, qui a réuni responsables syndicaux·ales et partenaires.
La campagne « La force du public » n’est pas qu’un simple appel à l’action. Elle incarne le pouvoir du mouvement syndical, comme l’illustrent les témoignages des membres de l’IE en Éthiopie, au Népal et ailleurs.
Des victoires dans le monde entier
Au Népal, la campagne a conduit à des victoires majeures pour les travailleur·euse·s de l’éducation. « Nous sommes descendus dans la rue pendant 29 jours », a raconté Kusmita Tiwari, membre de l’ Institutional School Teachers’ Union (Syndicat des enseignant·e·s d’écoles privées – ISTU) du Népal. « Près de 15.000 enseignants et enseignantes étaient venus de tout le pays. Cette action, menée sans relâche, a débouché sur un accord fédéral et une augmentation du financement de l’enseignement public de 110 millions de dollars au cours des trois prochaines années. »
Kusmita Tiwari a fait part de son expérience de la campagne au Népal et de la manière dont la coopération entre syndicats a permis de remporter des victoires majeures.
Yohannes Benti, président de l’ Ethiopian Teachers Association (Association des enseignant·e·s éthiopien·ne·s – ETA), a mis en avant l’impact de la campagne en Éthiopie : « Il y a deux ans, l’ETA a bénéficié du fonds de solidarité pour la campagne ‘La force du public’. En Éthiopie, le projet comportait plusieurs volets, notamment une enquête sur les dépenses publiques, des spots diffusés dans les médias et une formation pour les personnes en charge de la campagne. » Également membre du Bureau exécutif de l’IE, M. Benti a ajouté que la campagne avait contribué à augmenter la visibilité de l’ETA et à sensibiliser la communauté dans son ensemble sur la double mission de l’organisation en faveur à la fois de l’éducation et des droits des enseignant·e·s.
Renforcer la solidarité et les capacités
Le succès de la campagne repose en partie sur l’aptitude du projet à favoriser la solidarité entre les syndicats et à renforcer les capacités des membres. D’après le directeur du Bureau régional de l’IE en Afrique, Dennis Sinyolo, on observe sur le continent trois tendances concernant la campagne : « Certains pays et syndicats ont bénéficié du fonds de solidarité de l’IE, d’autres ont été soutenus par la Fondation Friedrich Ebert et enfin, il y a les organisations membres qui ont lancé la campagne de leur propre initiative et n’ont demandé à l’IE qu’un appui technique, du matériel et des conseils. Au total, en additionnant tout cela, on arrive à un lancement conjoint dans 26 pays africains. »
M. Sinyolo a par ailleurs mis en lumière l’importance de fonder le plaidoyer sur la recherche et les données. « Il est essentiel de commencer par mener des études et de recueillir des données afin d’appuyer votre plaidoyer et vos campagnes », a-t-il précisé, avant de présenter des exemples de projets conduits avec succès en Ouganda, au Kenya et au Zimbabwe, où la campagne a influencé les débats parlementaires et contribué à augmenter les budgets dédiés à l’éducation.
Pour sa part, Anand Singh, directeur du Bureau régional Asie-Pacifique de l’IE, a abordé les ambitions de la campagne en ce qui concerne la mobilisation : « Nous avons consciemment élaboré une stratégie en matière d’organisation. Certes, nous nous servons également de la campagne comme d’un outil de renforcement des capacités, mais nous nous concentrons surtout sur l’implication des membres et sur l’engagement politique, et nous utilisons la force des syndicats pour promouvoir nos objectifs de campagne. »
Il a en outre mis en avant la stratégie délibérée d’aligner des projets existants avec la campagne, voire de les y intégrer. « Par exemple, en Indonésie, où nous travaillons depuis 20 ans, le but était de former un syndicat puissant, démocratique et indépendant. Désormais, nous utilisons cette force pour construire la campagne et nous avons réussi à obtenir certaines réussites grâce à l’Association des enseignants et enseignantes de la République d’Indonésie (PGRI, de son acronyme en indonésien), qui a très bien dirigé cette campagne. » Lors d’un événement récent, a-t-il rappelé, « près de 200 personnes étaient présentes dans la salle et plus de 2 000 autres ont assisté en ligne, démontrant la capacité de PGRI à diffuser le message de la campagne dans toutes ses provinces d’intervention, auprès de toutes ses branches et sous branches, etc. » (lien disponible en anglais).
De plus, M. Singh a reconnu que la campagne est menée par les organisations membres : « nous nous contentons de les soutenir, a-t-il expliqué. Dans certains pays, nous ne fournissons aucune aide financière directe mais plutôt une assistance technique. Par exemple, l’an dernier nous avons réuni la sous-région d’Asie du Nord, à savoir le Japon, la Mongolie, la Corée du Sud et Taïwan ».
Soulignant l’importance d’ une approche régionale et sous-régionale, il a précisé : « Nous essayons d’impliquer nos partenaires tels que l’UNESCO ou l’Organisation internationale du Travail (OIT). Au cours des deux dernières années, nous avons organisé au moins cinq événements sous-régionaux ou régionaux auxquels ont participé des chefs de bureaux de l’UNESCO et de l’OIT, lesquel se sont engagés à soutenir la campagne. »
Perspectives d’avenir
À mesure que la campagne « La force du public » progresse, elle continue de s’adapter et de se développer. « Nous réfléchissons également à notre mutation vers un mode d’organisation facilité par la campagne », a déclaré Rebeca Logan, directrice des campagnes et de la communication de l’IE.
Elle a expliqué que la dimension de mobilisation et d’implication des membres permet de faire en sorte que la campagne reste un moteur de changement dynamique et réactif. Plus qu’une simple série d’initiatives, il s’agit d’un mouvement qui rassemble des syndicats de l’éducation du monde entier autour d’une mission commune visant à promouvoir l’enseignement public de qualité. Alors que la campagne continue d’évoluer, elle nous rappelle avec force ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les syndicats s’unissent et font front commun.